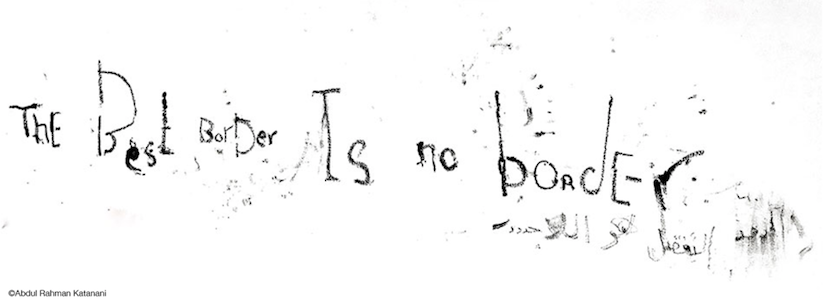Peintre, dessinatrice, narratrice, Eva Magyarosi (Hongrie, 1983) est une magicienne de l’animation. Ses dessins animés, au style balançant entre onirisme et réalisme, mettent en scène un univers devenu rare dans l’art contemporain, celui de la vie intérieure. La part secrète, l’intimité discrète de cette femme trentenaire vivant non loin de Budapest, sont le ferment d’une existence intense. La vie, somme d’actions, est plus encore un récit, récit du quotidien, récit des sensations, récit de l’amour et de ses variations, récits des peurs qui balisent à répétition tout sentiment de bonheur et de plénitude, récits, encore, des jeux croisés du narcissisme et de la cruauté ravageuse, celle que l’on attise contre soi-même.
Où les réseaux sociaux ont périmé l’intime et mis en avant, de façon conventionnelle et normative, l’extimité, cette exposition par tout un chacun de sa vie privée, les créations d’Eva Magyarosi recentrent l’individu sur lui-même et pour lui-même d’abord. Qui suis-je ? Qui est ce moi qui est moi ? Riche d’une extraordinaire floraison de moments secrets, d’aveux murmurés, d’obsessions diversement saintes ou perverses, de figures de ses proches ou tout aussi bien imaginaires, l’univers plastique d’Eva Magyarosi cultive un goût travaillé pour l’émerveillement. La vie est là, ma vie privée, le conte vrai qu’en extrait l’artiste est la célébration d’un quotidien vécu à fleur de sentiment, dans la peau d’un corps toujours profond, puits prodigue de sensations et d’émotions.

Multimedia artist Eva Magyarosi (Hungary, 1983) is a creator of magical animated videos whose experimental body of work also includes painting, drawing and story-telling. Lying between realism and dream world, her videos depict a universe that has become rare in contemporary art: the inner life. The secret part and the discreet intimacy of this thirty-seven-year-old artist living near Budapest is the ferment of an intense existence. Notions of hiddenness and secrecy, of discretion and intimacy become in her work fertile ground for an intense existence. Everyday life and the multiple actions of which it is made are transformed into narratives about existence, about sensations, about love and its variations, about the fears that repeatedly mar our feelings of happiness and fulfillment, and at times about the complex, self-destructive games of narcissism and devastating cruelty we play.
In spaces in which social networks have erased intimacy and, in a conventional, normative way, drawn attention to extimacy, Eva Magyarosi’s work returns focus to individual, private narratives. Who am I? Who is this “self” who is “myself”? She cultivates an elaborate taste for wonder articulated around secret moments, confessed murmurs, obsessions holy or perverse, family members real or imagined. In the artist’s hands, life, our private life, our daily life, is both a fairytale and a true story, a celebration of life lived on the edge, lived from inside the skin of a body that becomes an ever-deepening well of sensations and emotions.

Éva Magyarósi (Veszprém, 1981) est une artiste multimédia basée à Budapest qui crée des sculptures, des photographies, des dessins, des nouvelles et des vidéos. L’art vidéo est certainement son médium le plus remarquable car il combine toute sa palette de techniques de production. Ses œuvres peuvent être vues comme des récits privés, suspendus entre onirisme et réalisme. Magyarósi est diplômée du département d’animation de l’Université d’Art-Design de Moholy-Nagy (2000-2005) et a été honoré en 2018 par le grand prix hongrois UniCredit. Elle a également représenté la Hongrie à la Biennale de Kochi-Muzaris en 2018. Ses expositions personnelles majeures sont Swindles Also Dream, musée Ferenczy, Szentendre (2018); Invisible Drawings, Kunsthalle, Budapest (2012); Cruel Games for Girls, Galerie Erika Deak, Budapest (2009). Les œuvres de Magyarósi figurent également dans d’importantes collections publiques et privées, notamment celles du MONA (Australie) et du Château du Rivau (France).
Éva Magyarósi (Veszprém, 1981) is a Budapest-based multimedia artist who created sculptures, photographs, drawings, short stories, and video art. The latter is her most noteworthy medium, fusing her wide arsenal of production techniques. Her artworks can be seen as visual diaries blending fictitious concepts with her personal life and stories. Magyarósi majored in Theoretical Studies in the Department of Animation at the Moholy-Nagy University of Art-Design (2000-05) and was honored in 2018 by the major Hungarian UniCredit award. She also represented Hungary at the Kochi-Muzaris Biennial in 2018. Her solo exhibitions include Swindles also dream, Ferenczy Museum, Szentendre (2018); Invisible drawings, Kunsthalle, Budapest (2012); Game for cruel girls, Erika Deak Gallery, Budapest (2009). Magyarósi’s work are in important public and private collections such as MONA (Australia) and Château du Rivau (France).


Barbara Polla et Paul Ardenne permettent à la jeune surdouée hongroise du dessin Éva Magyarósi d’être, enfin, présentée à Paris. Un critique hors norme, et deux femmes d’exception qui se rencontrent. De quoi susciter la curiosité. La Diagonale de l’art a voulu comprendre les secrets de cette nouvelle alliance.
La passion de Barbara Polla femme médecin, écrivaine, mère, curatrice, ex-conseillère nationale libérale Suisse semble évidente lorsqu’on découvre le caractère de profusion hybride dont témoigne l’œuvre de la jeune artiste hongroise ! En regardant la vidéo de l’artiste projetée dans première salle d’exposition de la galerie 24 Beaubourg, nous demandons à la galeriste d’en expliquer sa genèse.
Barbara Polla : « Il y a 42 dessins qu’elle a fait pour préparer l’animation que l’on peut voir dans la première salle. Et ce sont tous des dessins qui datent de la fin 2018, début 2019. »
Le sentiment d’étrangeté mêlé à une douce cruauté est immédiat.
« Il y a toujours une dualité dans les dessins d’une part maudite, et un souffle de douceur. Ainsi ce qu’Éva Magyarósi dit des mains, est très beau. Les mains sont à la fois la caresse angélique, mais également la plaie, le coup, la violence ! »
Effectivement, une violence sourde est manifeste dans l’œuvre de l’artiste hongroise. « Mais elle est sublimée », ajoute aussitôt Barbara Polla.
« En Hongrie où elle enseigne elle est la star de l’animation – mais hélas, on ne la connait peu en France, à part le Château du Rivau en France où elle a fait une résidence récemment.«
De fait, Éva Magyarósi (Veszprém, 1981) est une artiste multimédia basée à Budapest. Elle crée des sculptures, des photographies, des dessins, des nouvelles et des vidéos. L’art vidéo est certainement son médium le plus remarquable car il combine toute sa palette de techniques de production. Ses œuvres peuvent être vues comme des récits privés, selon l’expression de Paul Ardenne qui assure le commissariat de l’exposition en partenariat avec Barbara Polla, des narrations intimes suspendus entre onirisme et réalisme. Elle est diplômée du département d’animation de l’Université d’Art-Design de Moholy-Nagy et a été honoré en 2018 par le grand prix hongrois UniCredit. Elle a également représenté la Hongrie à la Biennale de Kochi-Muzaris en 2018. Ses expositions personnelles majeures ont été présentées au musée Ferenczy, Szentendre en 2018; auparavant au Kunsthalle de Budapest en 2012. Ellea une galerie à Budapest depuis 2009 (Galerie Erika Deak). Les œuvres de Magyarósi figurent également dans d’importantes collections publiques et privées, notamment celles du MONA (Australie) et du Château du Rivau (France).
« D’abord elle fait des dessins comme elle voit le personnage de Tundra qui est un personnage non genré, ce n’est ni une fille ni un garçon, c’est Toundra. Et ensuite pour l’animer, elle va prendre une partie de la jambe, une partie du bras, le bâton séparément, la tête, et elle va introduire toutes ses différentes parties dans le programme d’animation. Ainsi, elle dessine les mains et ensuite elle va mettre les doigts dans le programme d’animation, pour animer, donner une « âme », et mettre en mouvement ses images. Pour cela, à l’instar d’un musicien, elle mixe ses images. L’œuvre d’Eva Magyarosi est d’une telle richesse qu’une exposition ne saurait suffire à en offrir un reflet fidèle. Installations, objets, sculptures, collages, vidéos… et le livre, l’un des chefs d’œuvres recelant en ses pages 120 dessins originaux, une vie d’artiste, entre chien et loup, intimité et sauvagerie, entre adultes et enfants, dans la magie des plaies ouvertes. La vidéo Invisible Drawings parle d’enfance, d’ancêtres, de transmission, du père bien aimé ; The Garden of Auras, jardin des délices version château français, parle de la puissance de l’imaginaire qui ressuscite même les cadavres enracinés dans les lierres d’un passé millénaire. »
Et pour mieux transmettre sa passion, Barbara Polla se fait traductrice de l’artiste :
« Comment puis-je raconter avec authenticité des récits privés dans un monde où l’industrie culturelle d’une part, et la nécessité de survie de l’autre, prospère simultanément, face à face ? Quelle importance accorder à la matérialisation de rêves personnels dans un monde aussi difficile, impitoyable que le nôtre ? Quelles sont les techniques et les méthodes, les symboles classiques et contemporains, que je puis utiliser pour désenclaver nos désirs, personnels et collectifs ? Mes œuvres existent tentent des réponses possibles à ces questions fondamentales pour moi. »
Le ton est donné… Nous ne serons pas déçu !
PAUL ARDENNE, RÉCITS TRÈS PRIVÉS
« C’est Barbara qui la fait connaître depuis une dizaine d’année maintenant. Ce qui la fait remarquer, c’est une œuvre de jeunesse appelée Fin du temps, des récits ciblés et corrélés à la vraie vie (comme dans Hanne, 2009, qui se nourrit encore de références à la vie privée de l’artiste). Le monde d’Eva Magyarosi est déjà construit autour d’une histoire simple et sobre entre jeunes adultes. Et ce qui m’a frappé immédiatement et m’a semblé extraordinaire, c’est d’abord ce choix du dessin animé, agrémenté à l’époque d’une technique d’incrustation de photos et d’images retravaillé sur des personnages déjà existant, des autoportraits parfois. Cela faisait un mixe extraordinaire. »
La Diagonale : C’était en quelle année ?
Paul Ardenne : «Il y a dix ans, Eva Magyarosi avait 25 ans.Pour caractériser Eva, du côté de la technique, il faut d’abord dire que c’est vraiment une artiste du dessin, de l’animation, avec un approfondissement de plus en plus sur le dessin animé. Elle a fini par supprimer progressivement les incrustations de photographies. Son travail devient de plus en plus graphique. Epuré, diaphane. » Et, côté propos, il y a toujours un sujet essentiel qui est condensé dans l’expression que j’ai donnée à cette exposition « Récits Privés », elle ne parle que d’elle ! »
Effectivement, si l’on observe chaque dessin ou chacune des séries animées, on observe à chaque fois que l’artiste nous parle de sa vie intime exclusivement.
LDA : C’est une histoire d’extimité. Et pourtant, si elle ne fait que se raconter, ce n’est pas du tout Facebooké, comme on peut le voir aujourd’hui avec une majorité de gens qui ne cessent de montrer « ce peu de réalité » de leur vie, leur sale petit secret. Le degré 0 de l’art comme le dénonçait Gilles Deleuze. L’art n’a rien à voir avec le compte-rendu de ses névroses, encore moins avec des histoires conjugales, familiales ou amoureuses.
Paul Ardenne :
« C’’est ce cadre qui m’intéresse. Car on voit aujourd’hui énormément d’extimité dans l’art, d’estime de soi, etc. »
LDA : Avec parfois une légitimité de bon aloi pour des minorées ( handicap, genre gay, minorités, etc.) Mais, on ne voit pas suffisamment que cette profusion d’extimité, ce désir de reconnaissance dans le regard de l’autre est aujourd’hui Facebooké par les techniques du numériques, et s’accompagne d’une forme d’appauvrissement de la manière dont on peut raconter sa vie.
Paul Ardenne :
« Chez la plupart de ces artistes du parti pris de l’extimité, cela part le plus souvent de bon sentiment, mais c’est souvent tellement conformiste, redondant, avec le sentiment d’avoir déjà vu ça des milliers de fois…Et puis surtout c’est terriblement ennuyeux ! »
LDA : On a également vu cela massivement dans le roman ces dernières décennies.
Paul Ardenne :
Effectivement, mais chez Eva Magyarosi si le propos reste purement conventionnel et d’une très grande banalité de prime abord, le traitement en revanche démultiplie complètement ce contenu dérisoire et vaniteux. Avec un style assez extraordinaire, pour Eva, surtout lorsque l’on voit la totalité de son travail aux proportions démesurées.
Pour lire la suite de l’article, cliquer ici
Vivant, donc instable
Dans l’organigramme des Récits privés d’Eva Magyarosi, Tundra représente moins un nouveau stade créatif qu’un approfondissement. De quoi est-il question ? Une fois encore, d’une histoire du corps, corps des humains, corps même de l’artiste – ce qu’elle est, ce qu’elle vit, comment elle le vit. Toute œuvre d’art est un autoportrait de son auteur.
Tundra, donc Eva Magyarosi ? Gageons que oui. L’artiste, cette fois, a endossé le frac analogique d’un animal de couleur blanche se mouvant dans une nature sauvage. Dans ce monde de début du monde, une horde libre d’animaux à robe noire court sur la plaine. Il y a dans ce groupe un animal blanc, pur comme le cygne des fables, qui s’ébat avec la meute, à son rythme. À peine remarque-t-on au-dessus de lui, comme un nimbe destinal, une sorte d’étoile noire qui le suit à la trace. Le signe d’une menace ? Sans nul doute.
Le premier dénouement de ce court film d’animation de 5 minutes de durée advient très vite. Une sorte de Mère majeure, que l’on a pu entrapercevoir en début de bande, au lever de rideau, tue net le blanc animal d’un coup précis de javelot. Fin de l’équipée sauvage. Demandons-nous au passage (l’artiste suggère cette possibilité) si la Grande Mère tueuse, celle qui met fin à un rêve de pureté et de liberté, n’est pas elle aussi l’artiste en personne, le double de l’animal blanc dont la course se voit brisée. Une figure de la castration, quoi qu’il en soit, et un acteur au rôle décisif, le pied sur le frein de la vie.

Scène après scène, Tundra dévide en une multitude de glissements plastiques le fil d’un devenir à la fois traumatique et vitaliste. Stade après stade, sous nos yeux et à coups d’images puissamment inventives, un corps évolue, se transforme. Corps d’enfant, corps de femme, cadavre de l’enveloppe duquel s’extraient des corpuscules divers, corps hybride « humanimal » à la fois humain et animal, corps humain et végétal, comme l’attestent ces épines récurrentes, dans maintes scènes, qui s’extraient ici des peaux comme des poils. L’animal blanc, innocent, pur, jeté dans le mouvement exalté du monde, meurt-il ? Qu’à cela ne tienne, ce n’est là que le début de l’aventure, l’aventure initiatique et compliquée du devenir. La mort n’étant que la continuation de la vie par d’autres moyens (le pourri est un bouillon de culture biologique, pas une extinction de l’Être), la transformation vient s’imposer dans Tundra comme la règle de ce devenir jamais éteint, dynamique et résurrectionnel. Exister, c’est endurer maints passages, maints glissements d’un état à d’autres états, c’est endurer cette fameuse métamorphose (celle des créatures d’Ovide comme du Kafka de La Métamorphose ou du Saint-Exupéry du Petit Prince) qui tout à la fois fascine et méduse nos consciences. La métamorphose fascine : ne nous permet-elle pas toutes les mutations, à la mesure de nos désirs de domination, d’absolu et de narcissisme ? Mais la métamorphose, tout aussi bien, méduse : elle est le signe du continuum éprouvant de la réalité soumise à l’empire du temps, un temps que rien jamais ne suspend, tyrannique, imposant de ne jamais espérer le repos métaphysique ou dit autrement, la stabilisation de soi. La meilleure et la pire des options pour raccommoder nos vies.
Un Bildungsroman, en quelque sorte. Un “récit de formation” comme peuvent l’être Les Souffrances du jeune Werther ou L’Éducation sentimentale. Sans que l’on sache jamais, au demeurant, dans quelle “scène” l’on se situe exactement. Dans la scène primitive chère à la psychanalyse, celle où se joue fondamentalement notre malédiction et où se calibre d’office notre droit au bonheur ? Dans celle du rêve ? Dans celle de l’invention et de la fantasmagorie ? Dans celle de l’expression de second degré ? À l’instar de la plupart des dessins animés d’Eva Magyarosi, Tundra est une mise en vue de l’intériorité moins réaliste qu’imaginaire se portant cette fois encore, familier à cette artiste hongroise, dans le champ flottant de l’introspection mentale. Fin du temps des récits ciblés et corrélés à la vraie vie (comme dans Hanne, 2009, qui se nourrit encore de références à la vie très privée de l’artiste), le monde d’Eva Magyarosi est ici celui de la chute d’attention, on y sort de la vigilance et, paupières tombées, on y intègre le registre du Eyes Wide Shut (1999), celui des « yeux grand fermés », pour reprendre le titre évocateur du dernier film de Stanley Kubrick. L’imagination, pour l’occasion, n’est pas la « folle du logis » mais une manière d’enrober ce qui se passe concrètement dans le « logis » corporel, en cœur de moi, au sein des mouvements de la psyché et du sentiment.

Tundra, avec le style propre et très imaginatif des récentes animations graphiques d’Eva Magyarosi, parle d’un état du corps qui est un devenir en devenir, une métamorphose qui se nourrit de ses propres implémentations, décidément et continûment incertaine. On vit et vivre, c’est expérimenter un passage du temps qui est aussi un passage de l’autoreprésentation de nous-mêmes. Aujourd’hui je me vois ainsi, hier je me considérais autrement et demain est un autre jour, un autre jour de l’autoreprésentation, la promesse d’une probable poussée d’instabilité, encore et encore. Les figures dans lesquelles le moi entend s’incarner changent, elles mutent, se dégradent et renaissent, leur mutabilité ponctue et écrit l’histoire d’une vie que les événements et les sentiments rendent malléable, moelleuse parfois, acérée tout autant. Cela, tandis que la question perdure : qui suis-je dans le temps ?
Paul Ardenne
Pour en savoir plus sur la vidéo Tundra, cliquer ici et pour en lire plus sur l’exposition, consulter la revue de presse ici













 ©Jérémy Chabaud
©Jérémy Chabaud
















 Curtis Santiago. Sour tasting of the imminent History
Curtis Santiago. Sour tasting of the imminent History





















 à la fois informe et ambigu et très clairement identifiable – mais pas n’importe quel Rhinocéros : celui gravé par Albrecht Dürer en 1515 ! L’histoire raconte en effet que le rhinocéros doré gravé par Dürer représente l’animal cadeau d’un Sultan de Cambay à Manuel 1er, Roi du Portugal, puis cadeau de celui-ci au Pape Léon X. Il fut le premier rhinocéros attesté sur le continent européen depuis 12 siècles. L’histoire dit aussi que Dürer n’aurait jamais vu l’animal. Mais qu’importe. Après une escale sur l’île mythique d’If (durant laquelle François 1er, Roi de France, vint le voir), le rhinocéros périt noyé : le navire le transportant sombre en pleine tempête en mer Méditerranée.
à la fois informe et ambigu et très clairement identifiable – mais pas n’importe quel Rhinocéros : celui gravé par Albrecht Dürer en 1515 ! L’histoire raconte en effet que le rhinocéros doré gravé par Dürer représente l’animal cadeau d’un Sultan de Cambay à Manuel 1er, Roi du Portugal, puis cadeau de celui-ci au Pape Léon X. Il fut le premier rhinocéros attesté sur le continent européen depuis 12 siècles. L’histoire dit aussi que Dürer n’aurait jamais vu l’animal. Mais qu’importe. Après une escale sur l’île mythique d’If (durant laquelle François 1er, Roi de France, vint le voir), le rhinocéros périt noyé : le navire le transportant sombre en pleine tempête en mer Méditerranée.